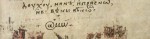Ce que l’impression 3D, l’open source et Internet combinés rendent possible, c’est la conception et la fabrication en petite série rentables.
Par Philippe Silberzahn.
L’impression 3D et la révolution qu’elle représente n’en finissent pas de susciter des réflexions – Même Le Monde en parle, c’est dire. Mais si on a tendance en général à se focaliser sur « la fabrication à la portée de tous » – qui a indéniablement une portée révolutionnaire, il y a un aspect également très important qui a trait au travail et à sa place dans la société. La révolution de l’impression 3D est la seconde mort de Descartes, voici pourquoi.
Je fais ici référence au dernier ouvrage de mon collègue et ami Pierre-Yves Gomez, Le travail invisible. Selon lui, la création de valeur due au travail se fait au travers de trois dimensions : la dimension subjective (la réalisation de soi dans le travail), la dimension objective (ce qui est produit par le travail) et la dimension collective (aucun travailleur n’existe et ne crée seul). La tendance de ces dernières années a été de nier de plus en plus des dimensions subjectives et collectives, pour ne plus se concentrer que sur la seule dimension objective, que l’on essaie de mesurer de plus en plus scientifiquement, avec des travers qu’évoque longuement Pierre-Yves. On est bien dans une conception cartésienne du travail avec d’un côté des penseurs (le management), et de l’autre ceux qui mettent en œuvre et fabriquent, avec plus rien entre les deux, une conception très cartésienne et séparation entre l’esprit (supérieur) et le corps (inférieur), dans laquelle l’action n’est nullement source de création, simplement d’exécution. J’ai évoqué dans un billet précédent d’où venait, selon moi, cette tendance. Mais comment la modifier ? C’est ici qu’intervient l’impression 3D.
Pour ceux qui auraient vécu sur Mars ces derniers mois, l’impression 3D (ou plus exactement fabrication additive) est une technique permettant de fabriquer des objets par déposition d’une couche de matière, un peu comme une imprimante à jet d’encre (d’où le nom). Le développement accéléré de cette technologie fait qu’il est possible de fabriquer un nombre croissant d’objets en un nombre croissant de matières, et l’abaissement du coût des imprimantes les met à disposition du plus grand nombre (certaines sont disponibles à partir de 400$). De là naît un mouvement, aux États-Unis d’abord mais qui se développe désormais dans le reste du monde, celui des « Makers », littéralement des fabriqueurs, qui voit des amateurs se consacrer à la conception et à la fabrication d’objets comme hobby. Certains le font tellement sérieusement qu’ils finissent par commercialiser ce qu’ils fabriquent, et l’on voit désormais se recréer des sites industriels dans des domaines depuis longtemps abandonnés aux États-Unis, contribuant ainsi à sa réindustrialisation (ce qui faisait récemment dire à l’un de mes amis qu’Arnaud Montebourg ferait plus pour la réindustrialisation française en subventionnant des imprimantes 3D qu’en nationalisant Florange, mais ceci est sans doute une autre histoire, quoique).
Naturellement, tout ceci est étroitement connecté avec Internet : des communautés de makers émergent sur le Web et co-créent (en open source) des objets aussi divers que des tasses de café ou des drones. Se développent également des « makers Faire », sortes de foires où les makers se rencontrent, échangent et, bien sûr, fabriquent. En aval, Internet sert également à vendre ces objets dans le monde entier. Ce que l’impression 3D, l’open source et Internet combinés rendent possible, c’est la conception et la fabrication en petite série rentables.
On le voit, le mouvement des makers remet en avant deux des dimensions du travail : la dimension subjective – le plaisir de faire – et la dimension collective – le plaisir de faire ensemble. C’est bien la seconde mort de Descartes, la pensée et l’action, individuelle et collective, se rejoignent, et l’action est à nouveau source de nouveauté et de création (le lien avec l’entrepreneuriat est ici évident). Que cela reste ensuite au niveau du hobby, ou que cela se traduise ensuite par une activité commerciale, c’est sans doute là le véritable aspect révolutionnaire du mouvement des makers et la technologie d’impression 3D sur laquelle il s’appuie. Pour revenir à l’ouvrage de Pierre-Yves, la grande entreprise, par son obsession de la performance et de la mesure, a étouffé les deux dimensions subjective et collective du travail. Plutôt que de se demander comment elle pourra les rétablir, peut-être suffit-il d’observer que d’autres formes de production et de création de valeur sont déjà en train de le faire sans elles. L’impact prévisible de cette substitution est difficile à anticiper, mais il semble assez évident que si un nouveau monde se construit sans ces grandes entreprises, elles ne tarderont pas à en sentir les effets.
https://www.contrepoints.org/2014/01/17/153591-la-revolution-de-limpression-3d-et-la-seconde-mort-de-descartes