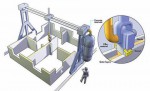Le religieux n’est jamais loin lorsqu’il est question de ces robots volants
Par Stéphane Stapinsky - Historien et essayiste. Il prépare un fascicule sur les drones pour une série que va lancer l’Encyclopédie de l’Agora l’an prochain.
Dans notre dossier Télé-réalité, il y a quelques années, nous constations une hypertrophie actuelle du regard : « Trois mots de même famille résument les effets de l’actuelle du regard : prospection, inspection, introspection. Prospection : voici l’ingénieur qui scrute les entrailles de la Terre, de la Lune et de Mars, avec l’espoir d’y trouver matière à exploiter. Il fonde ainsi ce que René Dubos appelait la civilisation de l’extraction. Inspection : Voici l’État et ses serviteurs qui nous font entrer dans l’ère du contrôle et voici, au terme de ce processus, Big Brother, à qui la télé-réalité permet, avec la complicité des victimes, de pousser son inspection jusqu’à la sphère la plus intime de la vie privée. Introspection : Voici l’inspecté qui, suivant les maîtres de la psychologie des profondeurs, prospecte et inspecte ses abîmes intérieurs. »
À cet œil, que l’on pourra bientôt qualifier de préhistorique, il manquait une lentille volante qui allait lui permettre de devenir omniprésent et donc omniscient. Cette lentille c’est le drone, si l’on veut bien entendre par ce mot tout véhicule volant sans pilote.
Dans La République, Platon raconte l’histoire d’un tyran, Gygès, qui tire son pouvoir d’un anneau magique : selon le sens où on le tourne, il rend visible ou invisible celui qui le porte. Ainsi armé, on peut tuer et régner par la terreur impunément. Ce mythe sur l’art de régner en voyant sans être vu a failli devenir une réalité à la fin du XVIIIe siècle quand Jeremy Bentham a lancé son idée de Panopticon, la machine ou plutôt l’édifice à tout voir, idéal pour les prisons où un seul surveillant placé au milieu de la place pourrait observer ce qui se passe dans chaque cellule sans être vu lui-même. Dans Surveiller et punir, Foucault a développé l’idée de Bentham en l’appliquant à la société tout entière : « [L]’effet majeur du panoptique[est d’]induire chez le détenu un état conscient et permanent de visibilité qui assure le fonctionnement automatique du pouvoir. Faire que la surveillance soit permanente dans ses effets, même si elle est discontinue dans son action ; que la perfection du pouvoir tende à rendre inutile l’actualité de son exercice. » On peut assurément soutenir, comme l’a dit un jour le député-maire français Noël Mamère, que le drone, « c’est l’application modernisée du panoptique à la ville entière, c’est un système de surveillance disciplinaire généralisé ».
Le religieux
Le religieux n’est par ailleurs jamais loin lorsqu’il est question des drones. Adam Rothstein, fondateur de Murmuration (« A Festival of Drone Culture », organisé en juin sur Internet) les compare à des anges « en orbite au-dessus de nos têtes, les nouveaux nomades astrologiques de nos destins mortels ». Selon Claire L. Evans, les drones nous troublent parce qu’ils « sont les agents d’une omniscience toute humaine qui se compare aux pouvoirs des dieux » (« Big Smart Objects : Drone Culture and Elysium, » Grantland, 14 août 2013).
Certaines peurs ancestrales revivent, car l’utilisation qui en est faite nous rappelle que, oui, « le ciel peut nous tomber sur la tête » et qu’il est possible d’être foudroyé par Zeus. « Les drones créent en moi de nouvelles formes de paranoïa : dans tous mes cauchemars adolescents les plus lucides à propos de l’avenir, jamais je n’ai été amenée à craindre une mort […] qui me viendrait du ciel. Maintenant, j’y songe régulièrement » (C. L. Evans). Les marines américains présents au sol lors d’une attaque de drone désignent d’ailleurs le faisceau laser envoyé par celui-ci sur sa cible avant l’instant fatidique comme « la Lumière de Dieu ».
Outil de destruction
Le drone est outil de destruction en même temps qu’outil d’inspection, un regard qui tue. Mille drones avec une minuscule tête nucléaire, lancés en même temps sur Hiroshima auraient pu avoir le même effet dissuasif que la bombe A. Mais personne à ma connaissance n’aurait eu l’idée de faire de la bombe A un objet esthétique, tandis que la chose semble aller de soi dans le cas du drone.
Un drone militaire comme le Predator — qui a l’air d’un gros oiseau tranquille — est un bel objet, tout en finesse, avec des courbes gracieuses. La conception de ce type d’aéronef procède assurément de la volonté d’imposer sa puissance par le biais de l’esthétique. C’est d’ailleurs une qualité des objets high tech : xontrairement à la technologie moderne, la haute technologie ne peut plus être définie uniquement en termes d’instrumentalité ou de fonction […]. Dans la haute technologie, la technologie devient davantage une question de représentation, d’esthétique, de style » (R. L. Rutsky, High Techne: Art and Technology from the Machine Aesthetic to the Posthuman, 1999).
Cette instrumentalisation de la beauté, même ceux qui critiquent le drone y succombent. C’est le cas d’artistes et d’intellectuels appartenant à une certaine avant-garde, largement anglo-saxonne, qui le prennent comme objet de leur travail. Plusieurs gravitent autour du festival Murmuration, créé par Rothstein.
Tout cela baigne dans un fond de technophilie, de festivisme et de transhumanisme qui me laisse perplexe. Dans cette appropriation du drone par un certain milieu culturel, on retrouve les contradictions de notre époque face à ce genre de technologie. D’un côté, on en stigmatise à juste titre certains excès ; de l’autre, ébloui, on se soumet sans rechigner au diktat de la société technicienne.