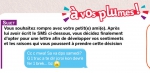Commune française située dans l'Ouest de la France. C'est le chef-lieu du département d’Ille-et-Vilaine et de la région Bretagne. Rennes compte 211 373 habitants intra-muros en 2013, ce qui fait d'elle la première ville de la région Bretagne, la deuxième ville du Grand Ouest et la onzième commune la plus peuplée de France en nombre d'habitants. L'unité urbaine est peuplée de 322 247 habitants en 2013 et son aire urbaine, qui comprend 700 675 habitants en 2013, est la dixième au niveau national. Rennes est le siège d'une métropole de 426 502 habitants (2013), faisant ainsi partie des 11 grandes métropoles françaises de droit commun (depuis janvier 2015).
Bref et vous l'aurez compris, Rennes est une grande ville dans laquelle vivent des tas de gens, une ville dans laquelle, normalement, il doit faire bon vivre. Sauf que... Sauf que, comme Nantes, elle est infestée par quelques dizaines de morpions d'extrême-gauche, des antifas, des no borders, des zadistes en tournée nationale, des blacks blocs et autres parasites. En gros, 500 gusses qui prennent un malin plaisir, régulièrement, dès que l'occasion se présente de mettre le bronx, de casser tout ce qu'il est possible de casser et de semer la désolation autant qu'ils suscitent la consternation parmi les habitants.
14 manifestations contre la loi travail cette année, autant d'opportunités pour ces excités d'affronter les forces de l'ordre, d'en découdre.
Et des habitants qui n'en peuvent plus, et des finances publiques qui paient les dégâts, et des commerçants qui n'ont plus que les yeux pour pleurer en constatant les dégâts et en attendant la prochaine augmentation de leurs primes d'assurance, sans compter les pertes de chiffres d'affaires.
Et un Préfet qui après avoir autorisé 13 manifestations qui ont toutes dégénérées interdit la quatorzième avec un mot d'ordre: Que les habitants restent chez eux cet après-midi !
500 connards prennent en otage le centre-ville de la onzième commune de France en nombre d'habitants et le Préfet de demander aux habitants de rester chez eux ! Non, mais allo quoi? On marche sur la tête.
La République ne serait donc pas capable d'assurer la sécurité de 322 000 habitants menacée par 500 connards? Euh... Y a comme un problème, là.
Sauf à considérer que les autorités, délibérément ou pas, ne se donnent pas les moyens de maintenir l'ordre et la sécurité pour tous... Et bien voyez-vous, je crois dur comme fer qu'effectivement ils ne se donnent pas les moyens de protéger Rennes. Pourquoi?
Vous verrez que ce soir les autorités se féliciteront du nombre record d'interpellation: 8? 12? 20?
Vous verrez qu'on nous annoncera, allez, 10 ou 20 gardes à vue, 3 à 4 comparutions immédiates et que d'ici un mois ou deux, on aura oublié et qu'aucun journaliste ne sera capable de nous dire si oui ou crotte un seul de ces connards a été condamné à de la prison ferme, encore moins si incarcération il y a eu.
Ce matin, François Hollande déclarait: "Aucune violence ne doit être acceptée". Violence, il y a eu. Son Préfet a déclaré: "On ne les laissera pas manifester, cette manifestation n'aura pas lieu. On fera respecter la loi, on fera respecter l'état de droit". Manifestation, il y a eu, les casseurs ont manifesté et loi et état de droit n'ont pas été respectés.
Le même a martelé: "La ville de Rennes n'a pas vocation à devenir un champ de bataille de casseurs violents" et la ville de Rennes, hier soir et cet après-midi a bien été un champ de bataille.
500 à 700 casseurs qu'on assurait ne pas laisser manifester ont affronté 7 compagnies de CRS (soit +/- 1000 pax), 4 canons à eau et deux hélicoptères, sans compter les voltigeurs en civils...
A Rennes, aujourd'hui, l'Etat a encore failli. A Nantes et à Toulouse aussi.
Et comme d'habitude, le Sinistre Cazeneuve ne devrait pas tarder à pointer son museau devant le micro et les caméras convoquées pour rendre hommage aux forces de l'ordre et nous assurer que tout sera fait pour que les coupables soient poursuivis et sévèrement condamnés.
Addendum de 18h33: Itélé annonce 15 interpellations
Lisez les commentaires: édifiants