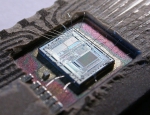Une nouvelle technique de modification du génome se répand dans les laboratoires du monde entier, facilitant la suppression ou l’insertion de gènes. Une équipe de chercheurs chinois vient de prouver qu’elle peut être appliquée aux embryons humains, et permettre de corriger des défauts génétiques. Et même pourquoi pas de céder à la tentation eugéniste…
Considérée comme l’une des plus importantes révolutions médicales de ces dernières années, la technique CRISPR-Cas9 donne la possibilité aux chercheurs de modifier le génome avec précision, en employant des " ciseaux moléculaires " capables de cibler des gènes spécifiques dans les cellules.
Pour ce faire, les scientifiques fabriquent tout d’abord un ARN artificiel (une méthode désormais éprouvée et maîtrisée) correspondant à la séquence d’ADN à découper, puis se servent d’une protéine bactérienne pour lier l’ARN à l’endroit voulu et retirer la séquence problématique. Dans la majorité des cas, cela se traduit par l’inactivation du gène " défectueux ". Il est également possible d’incorporer dans la cellule un ADN similaire à celui qui a été coupé contenant cette fois la " bonne " séquence.
Depuis sa découverte, des équipes du monde entier se sont approprié cette technique simple et peu coûteuse de modification du génome en la testant sur des bactéries, sur des cellules de plantes et d’animaux ainsi que sur des cellules humaines somatiques en culture. En quelques mois, elle a fait l’objet de plusieurs centaines d’articles dans des revues scientifiques !
Une équipe chinoise appartenant à l’université de Sun Yat-sen à Guangzhou vient de franchir une nouvelle étape dans cette course technologique en prouvant qu’il est également possible de modifier le génome d’un embryon humain, ce qui ouvre un champ vertigineux de possibilités.
En utilisant des embryons humains non viables (pour éviter les critiques), les chercheurs ont supprimé un gène responsable de la thassalémie bêta, une maladie héréditaire provoquant une anémie. Sur les 86 embryons utilisés pour l’expérience, le retrait de la séquence d’ADN problématique a fonctionné sur 28 d’entre eux ! Et quelques embryons ont su utiliser la séquence artificielle pour s’auto-réparer.
Si les essais cliniques (qui requièrent un taux de réussite proche de 100%) sont encore loin, nul doute que cette méthode va être considérablement améliorée dans les années à venir. Et les visées thérapeutiques sont aussi nombreuses qu’enthousiasmantes : la correction de gènes responsables de certaines afflictions héréditaires ou encore de gènes connus pour favoriser l’apparition de cancers ou d’autres maladies.
Cependant, faciliter à ce point le génie génétique pourrait avoir d’autres applications bien plus sensibles et délicates sur le plan éthique. Par exemple, en employant cette technique sur les cellules germinales qui affectent la descendance, il est théoriquement envisageable de créer dans un avenir proche des êtres humains génétiquement " améliorés " dotés de meilleures capacités physiques ou intellectuelles…
Source : Chinese scientists genetically modify human embryos – Nature
Par Aymeric Pontier. Contrepoint.org