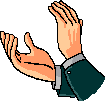L’affaire Benzema : Foot et Grand Remplacement
Chronique de Paysan Savoyard
L’affaire Benzema : le foot, illustration tangible du Grand Remplacement
Karim Benzema a déclaré que D. Deschamps ne l’avait pas sélectionné parce qu’il avait cédé à la partie raciste de la France. J. Debbouze a ajouté qu’il trouvait anormal qu’il n’y ait aucun maghrébin dans l’équipe de France. E. Cantona, dans le rôle du « dhimmi » islamo-gauchiste, a estimé que si D. Deschamps n’avait pas sélectionné de maghrébin, c’était peut-être « parce que personne dans sa famille n’est mélangé avec quelqu’un, comme les Mormons d’Amérique ». Cette affaire Benzema et l’évolution du football de façon plus générale, offrent une illustration parlante de ce qui est en train de se produire en France et en Europe.
-L’immigration se traduit par le communautarisme.
Elle ne débouche pas sur l’intégration, encore moins sur l’assimilation : dans une société multiculturelle et multiraciale, chacun raisonne en fonction d’une logique communautaire. Cette société communautarisée est nécessairement conflictuelle, chaque communauté cherchant à prendre le pas sur les autres. L’évolution du football en France et en Europe illustre cette situation.
On peut ainsi constater que la plupart des joueurs Français issus de l’immigration ne chantent pas la Marseillaise. Il en est de même en Allemagne, où les trois joueurs immigrés (Boateng, Ozil et Khédira) ne chantent pas l’hymne national. De même les supporteurs Français d’origine immigrée montrent qu’ils ne se sentent pas membres de la communauté nationale : ils supportent les équipes de leur pays d’origine, en arborent les drapeaux et les maillots ; lors des matches France-Algérie, les supporteurs Français d’origine algérienne sifflent l’hymne national.
Les joueurs Français manifestent également leur différence religieuse. F. Ribéry fait un signe d’appartenance à l’islam, auquel il est converti, en entrant sur le terrain. Anelka et Benzema arborent une barbe d’aspect manifestement islamiste. Les joueurs musulmans ont obtenu que la nourriture servie soit halal (selon ce que l’on a compris, même les joueurs non musulmans sont conduits à manger halal).
-Le football illustre le Grand Remplacement qui est à l’œuvre.
Les Blancs sont désormais en minorité dans les équipes de France de football (équipe première et espoirs) ; dans la plupart des équipes de clubs aux différents niveaux ; dans plusieurs autres sports collectifs.
Les jeunes de souche européenne en effet fuient les clubs de football : parce qu’ils y sont minoritaires ; parce que l’islam y occupe une place croissante ; parce qu’ils n’ont pas l’habitude des rapports de force que leur imposent les joueurs d’origine immigrés.
Le football illustre également le fait que les Blancs sont la cible de l’hostilité des personnes d’origine immigrée. Ils sont insultés et méprisés. Lors de la coupe du Monde en Afrique du Sud, il semble que le sélectionneur R. Domenech ait été traité de « fils de pute » par N. Anelka. Le joueur du PSG S. Aurier a qualifié l’entraîneur L. Blanc de « fiotte » sur les réseaux sociaux. On a cru comprendre également qu’en Afrique du Sud, J. Gourcuff avait été mis à l’écart car trop représentatif du joueur Français et Blanc.
Ces jours-ci, alors même que les Blancs sont depuis longtemps minoritaires en équipe de France, les responsables Français du football sont pourtant accusés de racisme pour ne pas avoir sélectionné de maghrébin.
-Une partie de la société française appuie les revendications des immigrés
C’est le troisième constat que le football permet d’illustrer. La classe dirigeante Française prend le plus souvent le parti des immigrés et de leurs revendications. A l’occasion de l’affaire Benzema, on voit ainsi différents intellectuels expliquer que le communautarisme et l’esprit vindicatif des immigrés, dans le football comme ailleurs, sont une réaction au comportement de la société française à leur égard. Les immigrés étant victimes du racisme, des discriminations et des difficultés sociales, leur susceptibilité et leur agressivité seraient compréhensibles.
Dans le même registre anti-Français un certain nombre de commentateurs expliquent que le nombre important d’immigrés en équipe de France prouve leur supériorité sportive. L’explication ne repose pourtant sur rien de tangible : l’Italie championne du monde en 2006 ne comprenait aucun immigré ; l’Espagne vainqueur en 2010 idem. Les immigrés n’étaient que trois dans l’équipe d’Allemagne championne en 2014.
https://leblogdepaysansavoyard.