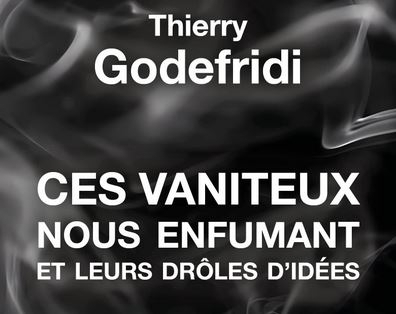L’extrême centre est une dystopie. Comme dans Le Meilleur des mondes d’Aldous Huxley, le ministre de l’Éducation nationale, Élisabeth Borne, veut commencer l’orientation dès le jardin d’enfants. C’est Parcoursup, dès mat’ sup, la maternelle supérieure!
Comme dans 1984 d’Orwell, il faut endoctriner les enfants avec les dogmes du parti et donc enseigner la sexualité et la théorie du genre dès le plus jeune âge. Claude Meunier-Berthelot, contributrice régulière de Polémia et auteur de Cette révolution scolaire qui tue la France, décrypte ci-dessous la circulaire ministérielle du 4 février 2025 sur l’éducation sexuelle, nouvelle étape de la révolution scolaire qui éloigne chaque jour davantage l’école de sa mission première d’instruction et de transmission au profit d’un gloubi-boulga politiquement correct. Polémia.
LA CHUTE CONTINUE
Nous sommes en train de toucher le fond de la perversité éducative avec l’introduction de programmes d’éducation sexuelle à l’école, de la maternelle à l’université! Révolution qui touche aussi bien l’école publique que l’école privée sous contrat.
Ceux qui sont censés nous gouverner continuent d’exercer leurs méfaits à la tête des institutions publiques malgré la levée de boucliers émanant notamment d’associations diverses dénonçant cette aberration éducative. Mais ne " baissons pas la garde " face à ce dévoiement organisé de l’Éducation nationale et de ses satellites, car l’avenir de nos enfants, l’avenir de la France en dépend.
Quelques pépites glanées dans différents établissements scolaires et relevées par l’association SOS Éducation