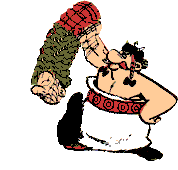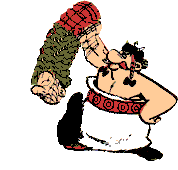Ce que les djihadistes ont compris de la France et ce qu'ils ont oublié
Par Roland Hureaux
A l'opposé des querelles franco-françaises, les djiahdistes ont compris mieux que certains responsables politiques que l'identité française englobait autant la République que l'Eglise, le prêtre que l'instituteur, argumente Roland Hureaux.
Agrégé d'histoire, énarque et normalien, Roland Hureaux est haut-fonctionnaire et essayiste. Il a notamment publié La grande démolition, la France cassée par les réformes (éd. Buchet-Chastel, 2012).
A une France qui s'interroge chaque jour sur son identité, les terroristes qui ont frappé à Nice et à Saint-Etienne-du-Rouvray ont, d'une certaine manière, répondu «Nous, nous savons ce que vous êtes. C'est précisément cela qui ne nous plaît pas et c'est là que nous voulons vous frapper».
L'attentat de Nice a eu lieu le 14 juillet, fête nationale, qui commémore certes la Fête de la Fédération de 1790 que le roi présidait, mais qui se trouve désormais liée à l'imaginaire républicain. C'est la France issue de la Révolution française qui était visée.
« Il est deux catégories de Français qui ne comprendront jamais l'histoire de France, ceux qui refusent de vibrer au souvenir du sacre de Reims ; ceux qui lisent sans émotion le récit de la fête de la Fédération »
Marc Bloch
L'assassinat d'un prêtre en plein milieu d'une messe à Saint-Etienne-du-Rouvray, c'est l'Eglise catholique, pilier millénaire de la civilisation française qui est la cible. Que cet attentat ait eu lieu le jour de l'ouverture des JMJ est-il un hasard? Ce n'est pas sûr.
Pour les terroristes, ces deux traditions n'en font que une. Elles sont toutes deux constitutives de la même France. On songe à Marc Bloch: «Il est deux catégories de Français qui ne comprendront jamais l'histoire de France, ceux qui refusent de vibrer au souvenir du sacre de Reims ; ceux qui lisent sans émotion le récit de la fête de la Fédération».
L'histoire de France ne fait certes pas vibrer les terroristes, mais ils l'ont mieux comprise que les enfants qui sont ou seront victimes d'une Education nationale façon Najat Vallaud-Belkacem, qui organise, sur fond de culpabilité, l'amnésie et l'inculture des générations futures.
Ils l'ont mieux comprise que nos laïcistes, tout puissants dans l'actuel gouvernement, pour qui seule compte la France républicaine, et qui pensent qu'un durcissement de la laïcité viendra à bout des terroristes, qu'il faut bannir les sapins de Noëls et les crèches des places publiques pour les apaiser. La très officielle Association des maires de France déconseille aux élus chrétiens de manifester leur foi en public. En revanche Anne Hidalgo fête ostensiblement la fin du ramadan à la mairie de Paris. Pour eux, l'Etat laïque doit tout faire pour échapper au soupçon de parti-pris pro-chrétien en faisant pencher au besoin la balance du côté de l'islam. Que le christianisme, qui ne fait peur à personne, soit la première victime d'une telle pratique et qu'une France déchristianisée soit une proie plus facile pour l'islamisme qu'une France qui aurait gardé la mémoire de ses racines chrétiens, ils ne veulent pas le savoir.
L'histoire de France ne fait pas vibrer les terroristes, mais ils l'ont mieux comprise que les enfants qui sont ou seront victimes d'une Education nationale façon Najat Vallaud-Belkacem
Que ce laïcisme, de l'école de Vincent Peillon, libertaire et anomique n'ait rien à voir avec celui de Jules Ferry, fondé, lui, sur une forte notion de la loi naturelle (appelée «morale républicaine»), issue de Rousseau et de Kant, leur échappe, ce qui témoigne de la crise profonde que traverse aujourd'hui l'idée de laïcité et par de là son incapacité radicale à contrer l'islamisme.
Tous ceux qui ont fréquenté des musulmans de France - et d'ailleurs -, qui ont fait par exemple une campagne électorale dans les cités où ils sont majoritaires savent que les musulmans préfèreront toujours un chrétien croyant à un athée. Plus la France se déchristianise, moins elle est capable d'intégrer.
Les terroristes ont aussi mieux compris ce qu'était la France que certains héritiers de l'école traditionnaliste, nombreux dans une certaine droite, qui depuis 230 ans ressassent de génération en génération leur ressentiment à l'égard d'une Révolution française supposée être à l'origine de tous nos maux. Ils ne voient pas que le vent libertaire, venu des Etats-Unis il y a une génération, a peu à voir avec la Révolution de 1789 et qu'elle marque une rupture de civilisation encore plus fondamentale, prémisse d'un transhumanisme suicidaire. Ils ne remarquent pas que ce qui reste de monarchies en Europe, notamment dans les pays nordiques ou le Commonwealth, ont été les plus ardentes à adopter les excentricités libertaires, contraires à une morale naturelle qu'aucun des philosophes des Lumières (sauf Sade) n'avait remise en cause.
A vrai dire les querelles franco-françaises de l'Eglise et de la République, du curé et de l'instituteur, à la rigueur comprises en Italie (Don Camillo et Peppone!) ou en Espagne, sont incompréhensibles pour le reste du monde. Pour les chrétiens d'Orient, la France de saint Louis et celle des Droits de l'homme, inséparables, sont deux moments d'un même élan historique. Il en est de même en Irlande, en Pologne, en Afrique ou en Asie.
Les querelles franco-françaises de l'Eglise et de la République, du curé et de l'instituteur sont incompréhensibles pour le reste du monde.
Des hommes aussi emblématiques du génie français que Chateaubriand, Péguy ou De Gaulle l'avaient compris. De même les hommes de la IIIe République qui, tout en combattant l'Eglise à l'intérieur avaient à cœur de remplir la mission multiséculaire de la France de protection des Chrétiens d'Orient, mission que Sarkozy et Hollande ont oubliée.
En frappant la France à la fois à Nice et à Saint Etienne du Rouvray, les terroristes ont fait la preuve qu'eux ont compris cela. L'acharnement qu'ils mettent à frapper la France ne s'expliquerait pas s'ils n'avaient, à leur manière, intégré que parmi les nations chrétiennes, en dépit de ses multiples reniements, la France demeure «la fille aînée de l'Eglise».
Il est en revanche une chose que les terroristes n'ont pas comprise, c'est que la France ne se laissera pas faire. On voit bien la logique de leur action maléfique: la terreur effraye, la terreur démoralise, intimide, tétanise, spécialement les faibles. Or, à leurs yeux, les Français, comme tous les Européens, sont devenus veules, décadents, ils ne sont plus capables de se défendre. «Complètement dévirilisés, ils marient même les homosexuels. Frappons-les et frappons fort, ils se rendront», pensent les terroristes islamistes. Dans «la guerre civile qui vient», les soldats d'Allah qui seuls ont conservé la flamme des premiers commencements seront croient-ils, les plus forts. Dans leur esprit, si la France bascule, toute l'Europe suivra. Les défaites des musulmans à Poitiers, Lépante et Vienne seront vengées.
Dans « la guerre civile qui vient », les soldats d'Allah qui seuls ont conservé la flamme des premiers commencements seront croient-ils, les plus forts.
Or ceux qui pensent ainsi se trompent profondément. Malgré l'état désastreux où se trouve aujourd'hui la société française, vingt siècles d'histoire nationale montrent que les Français ont toujours eu en réserve des ressources insoupçonnées, qu'ils ont toujours su se ressaisir quand il le fallait, spécialement quand ils étaient le plus insolemment agressés. Non, messieurs les djihadistes, la France millénaire ce n'est pas, comme le répand une certaine doxa de gauche, celle de Pétain, elle est, dès avant Jeanne d'Arc, celle de la Résistance.
A l'opposé de leurs espoirs, ou de ceux qu'inspirent certains imams aux prêches du vendredi, il existe une identité française, diverse dans ses composantes mais unique et infiniment plus solide que ce qu'ils imaginent. Daesh aura à cet égard été plus efficace que tous les débats sur l'identité nationale pour nous révéler ce qu'est cette identité. L'immense émotion qui a suivi l'assassinat de ce pauvre prêtre de 85 ans en est le signe.
Là est notre espoir.
http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2016/08/08/31003-20160808ARTFIG00163-ce-que-les-djihadistes-ont-compris-de-la-france-et-ce-qu-ils-ont-oublie.php