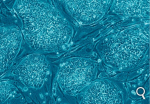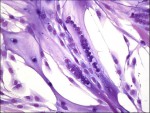Les objets connectés, au centre d'un nouvel écosystème de santé ?
Présentée par certains comme la première révolution technologique du XXIème siècle, l’internet des objets — c’est-à-dire la communication entre objets — tisse solidement sa toile dans notre quotidien. En effet on estime à 15 milliards le nombre d’objets connectés aujourd’hui et à 80 milliards en 2020.
C’est donc dans ce contexte que l’Atelier BNP Paribas et l’ifop sont allés à la rencontre des Français afin de déterminer leur usage de ces objets et les changements qu’ils sont en passe de provoquer dans leur vie.
Ainsi, l'étude montre que si les Français possèdent dans leur quasi-totalité des appareils de mesure des données physiologiques comme la balance ou le thermomètre, la part de la population disposant d’objets de mesure connectés ne dépasse pas les 11% ! Ces résultats montrent que malgré l’expansion de terminaux mobiles toujours plus sophistiqués, la connaissance de l’existence même des objets connectés n’est que peu répandue.
La principale raison tient au fait que les professionnels de santé n’apparaissent pas moteurs dans la diffusion de ces outils de mesure. En effet, seuls 16% des possesseurs d’objets connectés en ont eu connaissance par leur pharmacie et 9% seulement via le corps médical. "Aujourd'hui les objets connectés de mesure ciblent le grand public et passent par (…) les grandes surfaces. C’est une stratégie délibérée mais cela les coupe à contrario de la prescription potentielle du corps médical et de la caution morale associée”, commente Matthieu Soulé, analyste stratégique à L’Atelier.
Malgré un débat actuel fervent quant à l’exploitation des données personnelles, 61% des utilisateurs accepteraient de partager les données recueillies grâce aux appareils de mesure connectés, principalement avec le corps médical. "Le corps médical reste aujourd'hui l'ultime référence en ce qui concerne les données médicales avec près de 63% des français qui préféreraient que ce soit les professionnels de santé devant eux-mêmes (42%) qui gèrent ces données” . On note cependant de grandes disparités à travers les âges et les genres : "On remarque dans les différents résultats que les personnes âgées sont celles qui possèdent le plus d'outil de mesure aujourd'hui (86%). Par ailleurs, les femmes sont plus méfiantes que les hommes concernant le partage des données avec le corps médical. Enfin les professions libérales et les cadres supérieurs (… ) sont les plus optimistes quant au fait que les objets connectés pourraient procurer dans le futur des soins médicaux à part entière”.
Source : Communiqué de presse du 5 décembre 2013